Qu’est-ce qu’avoir confiance ?
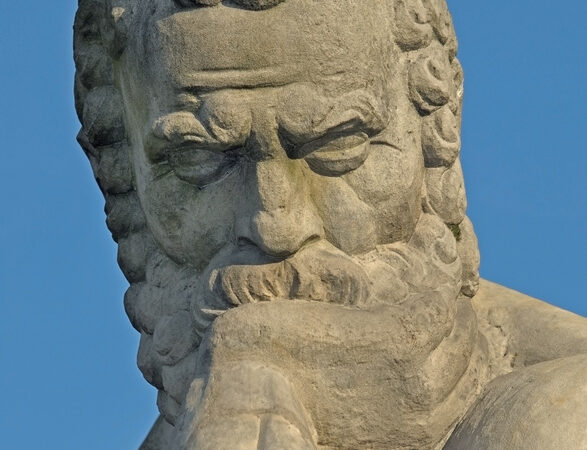
Peut-on encore avoir confiance ?
Replonger dans l’écriture de nouveaux articles est toujours un exercice difficile, à bien des égards, surtout lorsque l’on a sérieusement envisagé de rendre son tablier.
Malgré cela, il y a des moments dans la vie, où l’on trouve le temps, ou bien le prétexte, pour dire des choses quelques peu plus personnelles et intimes afin aussi de tenter de retrouver l’énergie nécessaire, de faire. Je me suis donc essayé à cet exercice pendant une période assez récente de ma vie.
Ces lignes sont en partie écrites, depuis l’Espagne, au cœur d’une pandémie dénommée Covid-19, et ce après plus de 6 mois d’inactivité professionnelle totale faute de ne pouvoir l’exercer librement.
Cette expérience, comme toute expérience, se devait d’être méditée, élaborée, et il m’a tenu à cœur de tenter d’y trouver un sens pouvant être utile.
Comme je l’avais par ailleurs écrit, les bases relationnelles de la confiance dépendent à minima des éléments suivants :
- Le rapport individu/société : c’est la question de l’éducation, du rapport au groupe social, et de l’apprentissage.
- Le rapport à l’histoire personnelle : c’est-à-dire la somme provisoire d’expériences et de rencontres cumulées.
- La dimension spirituelle, non nécessairement religieuse, propre à chaque personne.
- La dimension binaire du sentiment de confiance : tout ou rien.
- Le « fond » de la personne, ce qu’elle est réellement comme personne ainsi que ces actes, pas la forme ou le comportement
de « surface ». - Le rapport à la loyauté : c’est-à-dire à la légalité ou à la loi relationnelle sous-jacente, le rapport à la norme structurante.
Un homme qui attaque des bébés au couteau peut-il être sauvé ?
Je reprends ici le quatrième point qui est, à mon sens, fondamental pour répondre à la question de la possibilité de refaire confiance : la dimension binaire du sentiment de confiance.
Pour pouvoir à nouveau faire confiance, il faut prendre une décision séminale avec soi-même : je choisis de faire, ou bien de ne pas faire, confiance mais je me refuse à l’entre-deux.
De fait, quel sens cela aurait-il de faire un peu confiance à quelqu’un ? D’avoir un peu confiance en l’avenir ?
Cette décision est séminale car elle doit permettre de fonder la naissance d’une nouvelle possibilité (versant positif) ou bien établir définitivement le renoncement à une autre possibilité (versant négatif).
Il est tout à fait possible de refaire confiance dès lors que l’acceptation du risque demeure supérieure à la possibilité que ce même risque engendre un niveau de souffrance égal, ou supérieur, à ce qu’il a déjà été par le passé.
Pour ma part, je ne retiens pas l’option de « l’entre-deux ».
Cette option évacue de fait, selon moi, la possibilité de croire en ce que nous allons appeler ici le « Mal » : si la question n’est pas clairement tranchée (croire ou ne pas croire), alors le Mal et les personnes malfaisantes qui ne savent produire que des actes malsains, auront toujours une longueur d’avance sur celles qui font un pas vers elles.
Nous ne pouvons pas combattre ce que nous n’arrivons pas à saisir clairement.
C’est donc une question philosophique, spirituelle et presque mystique, qui sous-tend la question de la confiance : le Mal existe-il en soi ? Les êtres malfaisants peuvent-ils permuter, c’est-à-dire changer ?
De mon point de vue, et pour reprendre l’exemple d’un dramatique fait divers récent: un homme qui attaque des bébés au couteau ne peut plus être sauvé, je ne pourrais plus me « fier par la foi », cum fidere, à cet « autre que soi ».
La confiance et le principe d’engagement.
Lorsque nous sommes confrontés à une épreuve de la vie, et que nous n’arrivons plus à nous projeter dans un futur, même proche, nous sommes alors fréquemment tentés par trois types de décisions :
- Soit, nous subissons l’épreuve et nous renonçons à ce qui était nos possibilités potentielles d’agir,
- Soit, nous gardons espoir en attendant que la tempête passe,
- Soit, nous essayons de retrouver le chemin du sens, un sens pour soi-même, un sens différent, à fortiori lorsqu’une épreuve peut nous paraître injuste ou insensée : on pourrait aussi évoquer ici l’idée de « transition » chère à William Bridges.
En effet, s’engager dans une direction, c’est s’engager vis-à-vis de soi-même, de quelqu’un, ou de quelque chose, mais c’est aussi, dans un même temps, se désengager du monde qui précédait.
Le principe d’engagement est ainsi le prolongement physique du sentiment de confiance.
Cela, j’ai également pu le vérifier au travers de mes 15 années d’expérience comme coach : sans confiance et sans engagement, rien ne tient, rien ne tient bien longtemps.
Les choses importantes ont besoin de temps pour se faire et se défaire tout autant.
Comme le précise le philosophe Joël Gaubert dans son article Pourquoi s’engager ? :
« S’engager, c’est le fait pour un soi (marqué ici par le « s’»), un sujet, un homme plus précisément, de s’ouvrir à un autre être (le monde, dont autrui) pour le rencontrer par le biais d’une action entrainant des effets, des changements, une transformation peut-être de cet autre voire de soi-même. »
Pour Joël Gaubert, l’engagement de l’homme peut se faire de trois manières :
- L’engagement de type « analytique » que l’auteur classe dans la catégorie « travail » : la référence sous-jacente est ici l’Homo œconomicus éprouvant des besoins naturels et exprimant des désirs vis-à-vis d’objets nécessaires à sa vie, voire sa survie, révélant ainsi une « logique de production, de l’échange et de la consommation ».
- L’engagement de type « herméneutique » relevant de la catégorie « œuvre » et « culture » : la référence sous-jacente est ici l’Homo socius, ouvert au monde et à autrui, par « la médiation d’un désir de reconnaissance (et pas seulement d’un besoin d’efficience) ».
L’homme s’engage ici dans un « monde culturel structuré par un sens commun ».
Il s’agit surtout, comme nous le précise l’auteur, de ne pas perdre sa vie en essayant de la gagner en prenant soin des us et coutumes, de nos croyances et de nos valeurs structurantes.
L’objectif visé est le vivre ensemble en préférant la compréhension à l’explication et la participation à la production.
- L’engagement de type « critique » relevant de la catégorie « action politique » : la référence sous-jacente est ici l’Homo theorethicus, « c’est-à-dire aspirant à la fois à la vérité (théorique) et à la liberté (éthique et politique). »
« Une telle conception éveille l’homme à sa capacite et son obligation de s’engager de façon éthique et politique (…). Il s’agit dès lors de s’engager pour transformer le monde, autrui et soi-même, pour changer l’existence en référence aux essences, aux Idées normatives du Vrai, du Bien et du Beau, selon le double projet de la sagesse personnelle et de la justice collective (…). » Ibid.
Ce qui peut m’engager dans mon travail avec une personne, ou un groupe, est avant tout la certitude (confiance en soi et confiance dans la possibilité de réalisation du changement) que la situation est juste : juste adéquation entre moi-même et la situation.
Dans mon métier, ce qui me mobilise réellement est un engagement de type critique, appliqué à la situation d’accompagnement.
Ce qui va, en revanche, contribuer à mon désengagement effectif correspond à des réalités vécues sur le terrain tout au long de mon expérience professionnelle :
- Manipulations et jeux de pouvoir à mon encontre.
- Fausses demandes déguisées et mauvais motifs.
- Perte de temps faute d’engagement réel des parties.
- Absence de motivation et de désir d’entreprendre.
- Prétentions déconnectées du réel.
- Pensées magique, sectaire, grégaire.
Puis-je vraiment réaliser tout ce que je désire ?
Confiance, désir et motivation.
Être motivé, c’est au sens le plus trivial poursuivre des motifs; mais c’est aussi disposer d’une force vitale que l’on pourrait opposer à l’oisiveté ou l’absence de motivation.
Imaginer un futur dans lequel je pourrais, par exemple, me projeter en visualisant les réalisations gratifiantes qui pourraient s’y produire est une source de motivation.
L’autre nom de la motivation est le désir : avoir du désir c’est tendre vers un but, un objectif aussi, en accordant à ce but une considération singulière, une importance reconnue et comprise par nous.
Pour ce qui me concerne, je pense me connaître suffisamment pour pouvoir dire que je suis, avant toute chose, une personne affective dans mes relations.
Je suis beaucoup plus motivé par les échanges sociaux lorsque les personnes ne se comportent pas comme des robots, des stratèges ou des moutons apeurés, tout comme j’ai beaucoup moins envie d’explorer un monde d’interdictions imbéciles, de frontières inutiles et de barrières placebos.
En ce sens également, je coopère et respecte grandement une personne qui pourra faire l’effort de ne pas émettre un jugement de prime abord sur moi ou mon semblable : il est, me semble-t-il, plus exigeant et responsable de suspendre son jugement durant un temps nécessaire, plutôt que de juger de prime abord dans la précipitation et la « rage de conclure ».
Le jugement de prime abord, c’est-à-dire l’étiquetage intempestif, est dans les relations interpersonnelles un véritable virus bien plus toxique que celui de la Covid 19.
C’est aussi, pour le dire d’une autre façon, redonner toute sa force et sa place à cette qualité profondément humaine : « l’ouverture d’esprit ».
- Examiner les choses et les problèmes sous le maximum d’angles possibles.
- Ne pas se précipiter rageusement à tirer des conclusions hâtives.
- Être capable de changer de point de vue lorsque de nouvelles informations nous prouvent que nous n’étions pas dans le vrai ou dans le juste.
- Faire preuve d’esprit critique.
Remotiver une personne, ou bien se remotiver soi-même lorsque cela est nécessaire, se possibilise à partir des remises en question que nous faisons, à partir des choix et des actions que nous réalisons :
- Qu’est-ce qui est essentiel pour moi ?
- Suis-je en accord avec mes valeurs et mes principes ?
- Suis-je en parfaite cohérence entre ce que je ressens, en mon for intérieur, et ce que j’exprime ?
Rapport de communication, lien de confiance et expression.
Tel est le titre du superbe ouvrage du psychologue et psychothérapeute américain Marshall Rosenberg qui est également le fondateur de la communication non-violente (CNV).
Je me suis toujours émerveillé de ce titre que je trouve tout à fait éclairant pour illustrer le propos et désigner les véritables problèmes autour de la communication interpersonnelle.
Effectivement, une communication juste, authentique et respectueuse, doit pouvoir offrir des perspectives (comme le ferait une fenêtre), un angle de vue, un accès, et inspirer confiance.
Elle doit aussi permettre de se réfléchir (comme le ferait un miroir ou la vitre de la fenêtre) pour nous voir faire en faisant.
Elle doit enfin permettre de transmettre, de faire passer d’un état à un autre, d’une réalité à une autre, et d’en assurer le passage, la voie, la voix.
L’absence de ces ingrédients communicationnels nous conduisent dans une impasse : c’est-à-dire l’absence de voie qui se matérialise par un mur froid et infranchissable.
Il y a un lien précieux, qu’il s’agit de soigner, guérir parfois, et faire grandir souvent, entre la voix (qui est l’instrument de la communication verbale et un des symboles de l’être humain comme « animal parlant ») et la voie (qui est le chemin d’accès de nos choix et actions par lequel nous pouvons aussi nous sentir appelés : la vocation).
Il faut pour cela, comme le souligne Marshall Rosenberg y mettre du sien et y mettre également du lien.
Comme l’avait très bien remarqué le philosophe Henri Maldiney, le rapport de communication, c’est-à-dire le lien de confiance et les manifestations d’échange, d’engagement, d’écoute et d’accueil qui s’installent entre deux interlocuteurs, n’a rien de comparable avec la technique de communication (qui est un outil au service d’un objectif déterminé).
Dans mon travail, j’ai la responsabilité professionnelle de ne pas confondre ces deux niveaux tout comme je me dois de savoir les reconnaitre et les différencier :
- Le rapport de communication est ce qui permet la rencontre entre deux personnes alors que la technique de communication est bien souvent ce qui oppose deux personnes dans un rapport déséquilibré au service du contrôle ou des jeux de pouvoir.
- Savoir bien parler ne remplacera jamais savoir être, mais ces deux niveaux peuvent aussi se réajuster positivement dès lors que la technique n’est pas utilisée à l’encontre de l’autre mais bien à son service ou plutôt au service de la rencontre.
Conclusion
Pour conclure et tenter de répondre à la question qui me hantais, comme une mauvaise ritournelle (Puis-je vraiment réaliser tout ce que je désire ?), sans en subir le sentiment d’injustice ou même la colère que j’éprouvais alors, je souhaite partager ceci :
- Ce n’est pas la quantité de choses que nous projetons de faire qui fera de nous un être heureux et épanoui.
- Ce n’est pas non plus la programmation chronologique (temps linéaire) dans le temps qui remplira ce rôle car il faut parfois, comme au Monopoly, repasser par la « case départ » (temps circulaire) pour comprendre quelque chose de fondamental.
Oui, tout peut-être réalisé dès lors que notre désir d’être, de poursuivre dans notre être, est authentique et a su métaboliser les erreurs et les échecs et demeure sain et sauf tout en poursuivant son engagement.
C’est bien la continuité du désir d’une personne qui peut lui permettre d’avoir toujours confiance en l’avenir, même si certaines pensées et croyances vont venir l’en dissuader.
L’auteure et conférencière américaine Katie Byron le dit plus clairement :
« Aimer ce qui est. »





